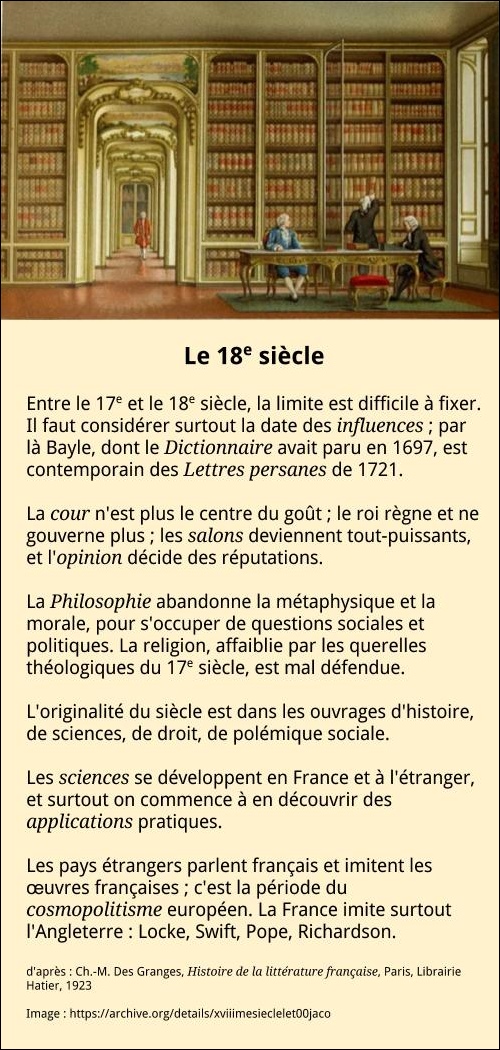a) Le courant rationaliste, philosophique
On réagit contre la toute-puissance de la monarchie, de la noblesse, de la Religion et de l’Église. On exalte la Raison et le libre examen. On prône la bonté originelle de l’homme, la liberté, l’égalité, la tolérance.
- MONTESQUIEU, L’esprit des lois
- VOLTAIRE, Candide
- DIDEROT et autres, L’Encyclopédie (1760-1770)
- BEAUMARCHAIS, Le barbier de Séville (± 1780).
b) Le courant sentimental
Cette tendance annonce le romantisme du 19e siècle. La sensibilité remplace la raison. Les thèmes courants sont: le moi, la nature, l’imagination, le coeur, le sentiment religieux.
- Jean-Jacques ROUSSEAU, Émile, Les Confessions, Les rêveries d’un promeneur solitaire.


Le XVIIIe siècle – Les philosophes
Le XVIIIème siècle français est le siècle philosophique, caractérisé dans la première moitié du siècle par le courant rationaliste et dans la deuxième moitié par le préromantisme qui supplantait l’idéal classique.
Caractéristiques générales
1. Les salons, les cafés, les clubs
La Cour n’est plus le centre du pays et l’inspiratrice des idées. Dans son rôle intellectuel et social elle est remplacée par les salons, les cafés et les clubs.
Encore essentiellement littéraires au début du siècle, les salons deviendront philosophiques dans la seconde moitié. Apparus pendant la seconde moitié du XVIIème siècle, les cafés se sont multipliés rapidement : on y échange des nouvelles et on y aborde les questions à l’ordre du jour. Ecrivains et philosophes s’y rencontrent.
Les clubs, institution anglaise importée en France, joueront un rôle important dans la Révolution. Mais déjà dès le début du siècle, les gens sérieux, s’intéressant aux questions politiques, se rencontraient au Club de l’Entresol (1720-1731).
2. Le rayonnement de la France
Au XVIIIème siècle, la France sert de modèle à toute l’Europe par sa littérature, ses manières, ses modes, sa langue.
Partout en Europe, on parle le français (p.ex. le roi prusse Frédéric II), on construit des châteaux inspirés de Versailles, on invite des écrivains et philosophes français.
3. Les influences étrangères
En France, on accueille les influences étrangères : la musique italienne, les oeuvres de Goethe, mais avant tout il y a une forte influence anglaise: le régime politique d’Angleterre inspire les philosophes Voltaire et Montesquieu, la littérature anglaise (Shakespeare, Macpherson) est traduite en français.
Cette anglomanie se révèle même dans les mœurs : on crée les clubs (cf.1.), on boit du thé, on préfère les parcs à l’anglaise.
4. L’esprit philosophique
Après la synthèse de la raison et la foi pendant la Renaissance et le dédoublement opéré au XVIIème siècle, le XVIIIème siècle consomme la rupture entre la raison et la foi. Désormais, seule la raison est capable d’expliquer le destin de l’homme.
C’est la mort de Louis XIV en 1715, qui semble le point de départ de ce nouvel esprit : après la contrainte subie tout au long de son règne, on aspire à plus de liberté.
Les philosophes rejettent toute autre autorité que celle de la raison humaine (le rationalisme) et soumettent à un libre examen toutes les traditions établies : la révélation, la religion, les institutions politiques et sociales. Ils préparent la fin du siècle en concluant à la tolérance, à l’instauration d’une plus grande liberté et l’abolition d’abus et de privilèges.

Op bovenstaand artikel is een Creative Commons Licentie ‘Naamsvermelding – Niet-Commercieel – Gelijk Delen 2.0’ van toepassing. Deze licentievorm maakt gratis gebruik in een onderwijscontext (non-profit) mogelijk.
Auteursrechten van dit artikel.

Les Lettres au XVIIIe siècle
Par l’influence que la littérature eut sur les idées, la France du XVIIIe siècle se place à la tête des nations; elle en est la souveraine. Au siècle de Louis XIV, on ne cherchait dans la littérature que les moyens de plaire ou d’émouvoir. Au XVIIIe siècle les écrivains travaillent infatigablement à détruire le principe de l’autorité absolue; ils ne veulent d’autres bases au pouvoir que la Loi établie sur le Droit et la Justice.
Le XVIIe siècle s’attachait à la forme, au style; il écrivait surtout en vers. Le XVIIIe se soucia moins de la forme; il écrivit surtout en prose. Ce n’est plus des anciens que les écrivains du XVIIIe siècle s’inspirent; mais de l’Angleterre.
C’est chez ce grand peuple qui, en face d’une Europe ployée sous des gouvernements despotiques, se gouverne selon une constitution libérale, que Montesquieu et Voltaire chercheront des programmes d’organisation politique.
La littérature du XVIIIe siècle présente deux périodes; mais la seconde n’est que la conséquence de la première. Deux noms caractérisent chacune de ces périodes. Pour la première, Montesquieu et Voltaire; pour la seconde, encore Voltaire et J.-J. Rousseau. Voltaire domine donc tout le siècle.
1re période, 1718-1755.
Dans cette période, les écrivains sont encore fervents royalistes; mais ils ne veulent plus du principe du « droit divin » et réclament hardiment des réformes. C’est dans cette période que Montesquieu publie ses Lettres persanes (1721), les Considérations sur les Romains (1734) et, en 1748, son ouvrage capital l’Esprit des Lois. C’est aussi dans cette période que Voltaire donne la Henriade (1723), qui est l’apologie de la Tolérance; l’Histoire de Charles XII (1729); et ses tragédies en vers. Enfin en 1752 il publie son grand ouvrage, le Siècle de Louis XIV.
2e période, 1755-1789.
Dans cette période J.-J. Rousseau paraît avec son Contrat social (1759), livre d’un caractère profondément démocratique, et la guerre se déchaîne contre la monarchie. Voltaire, installé à Ferney, correspond avec les rois, mais il examine, et tous les penseurs avec lui, le principe même des institutions: royauté, clergé d’État, noblesse. Tout ce qui n’a pas la « raison » pour base est rejeté.
Aux trois précurseurs de 89, s’ajoute Beaumarchais. Dans le Mariage de Figaro, il se révolte contre la société entière: noblesse, magistrats, diplomates, gouverneurs, etc. Beaumarchais ose personnifier, dans son Figaro, l’homme du tiers, plein de talents, d’activité, d’habileté, qui veut être quelque chose, mais ne peut, parce qu’il est peuple, arriver à rien. « Le mariage de Figaro, c’est la révolution avant la Révolution … Voltaire avait commencé la guerre avec une gaîté amère, Beaumarchais la finissait avec un éclat de rire ». A. Houssaye
Les Encyclopédistes.
Le XVIIIe siècle eut aussi des philosophes scientifiques, les Encylopédistes. Sous la direction de Diderot (1713-1784), Condillac, Helvétius et d’Alembert, ils entreprirent de publier l’encyclopédie des connaissances humaines. Enfin, une science nouvelle, l’économie politique, date du siècle de Voltaire; elle eut pour créateurs: Gournay, Quesnay et l’Écossais Adam Smith.
Œuvres légères et charmantes.
Bernardin de Saint-Pierre et Marivaux ont laissé, l’un, des modèles de tendresse; l’autre, des modèles de grâce. Retenons aussi les contes de Voltaire.

| Le 18e siècle |
| Les dernières années du règne de Louis XIV furent marquées, à l’extérieur, par des guerres malheureuses, et, à l’intérieur, par la misère et un redoublement de despotisme. Quand il mourut, il y eut comme un sentiment de soulagement. Les esprits, délivrés d’une autorité qu’on ne respectait plus, se mirent à user et à abuser de leur liberté. Les mœurs s’en ressentirent, et avec les mœurs la littérature. Elle devint agressive, curieuse de nouveautés, ambitieuse de perfectionnement, pratique, matérialiste, licencieuse. Elle touche à tous les problèmes, agite toutes les questions, discute tous les principes et toutes les croyances. Des écrivains de toute espèce prennent part à une remarquable mêlée intellectuelle. Il y en eut un grand nombre, et quelques uns d’une grande valeur. Quatre d’entre eux se sont placés par leurs œuvres au-dessus des autres : c’est Voltaire, J.-J. Rousseau, Montesquieu et Buffon. |
Source: Aubert 2 Op bovenstaand artikel is een Creative Commons Licentie ‘Naamsvermelding – Niet-Commercieel – Gelijk Delen 2.0’ van toepassing. |